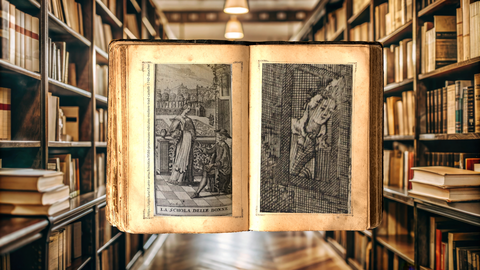
Colloque international : "Traduire les "sales équivoques" de Molière en italien, du XVIIe siècle à aujourd'hui
Colloque organisé par Carine Barbafieri (Université Polytechnique Hauts-de-France) et Françoise Poulet (Université Bordeaux Montaigne / IUF)
Vaugelas, dans ses Remarques sur la langue françoise (1647), et à sa suite la plupart des théoriciens de la langue, tel Bouhours, condamnent les équivoques comme des fautes de grammaire et des vices de style au titre de la clarté et de la pureté de la langue : « Il n’y a jamais eu de langue où l’on ait parlé plus purement et plus nettement qu’en la nôtre, qui soit plus ennemie des équivoques et de toutes sortes d’obscurités, plus grave et plus douce tout ensemble, plus propre pour toute sorte de style, plus chaste en ses locutions, plus judicieuse en ses figures, qui aime plus l’élégance et l’ornement, mais qui craigne plus l’affectation […][1] ». Dans le chant I de l’Art poétique (« Votre construction semble un peu s’obscurcir ; / Ce terme est équivoque, il le faut éclaircir », v. 205-206), mais plus encore dans la Satire XII, Boileau reprend cette condamnation à son compte. Dans le « Discours de l’auteur » qui précède cette satire, le satiriste explique qu’il entend équivoque, non pas « dans toute l’étroite rigueur de sa signification grammaticale », mais « comme le prend ordinairement le commun des hommes, pour toutes sortes d’ambiguïtés de sens, de pensées, d’expressions, et enfin pour tous ces abus et ces méprises de l’esprit humain qui font qu’il prend souvent une chose pour dire une autre[2] ».
Le Dictionnaire de Furetière définit l’équivoque comme un « terme qui a plusieurs significations », et donne deux exemples d’équivoques, l’une qui correspond à une faute de la part du locuteur, à moins qu’il ne s’agisse d’une faiblesse de la langue elle-même (« le besoin qu’a notre Langue de relatifs fait faire plusieurs équivoques »), l’autre qui est une beauté propre à un genre littéraire (« Les équivoques font souvent la pointe, la beauté d’une Epigramme »). D’où la conclusion de la notice de Furetière : « Il y a de bonnes et de mauvaises équivoques ».
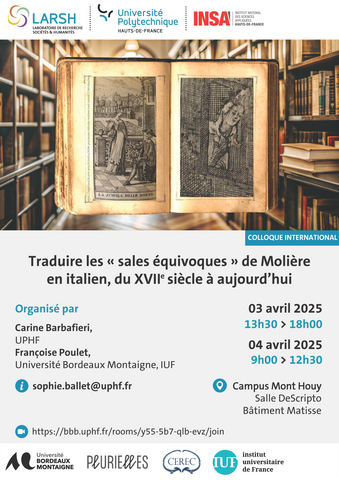
Du côté des mauvaises équivoques figurent en particulier les « sales équivoques », celles qui contiennent un double sens scabreux et sexuel, que Racine, dans l’avis « Au lecteur » en tête des Plaideurs, se vante de ne pas avoir pratiquées, à la différence de Molière qui s’est illustré dans ce type de plaisanteries et qui en a lancé la mode, aussi bien dans la petite comédie en une acte (Les Précieuses ridicules) que dans la grande comédie en cinq actes et en vers (L’École des femmes). La préface des Remarques de Vaugelas, qui oppose l’équivoque au style « chaste », montre en effet que l’ambiguïté, en matière linguistique, est vite susceptible de basculer du côté de la grivoiserie, plus ou moins choquante.
Ce sont ces équivoques sexuelles, plaisanteries grivoises (qui évoquent joyeusement la sexualité) ou obscènes (qui agressent en montrant ce qui ne devrait pas l’être), plus ou moins voilées, que cette journée d’étude se propose d’examiner, sous l’angle de la traductibilité, dans la langue sœur du français qu’est l’italien. Comment traduire les équivoques de mots jouant sur les sonorités con, ca, vi, « syllabes sales » ? Comment traduire les équivoques de pensée qui, tout en semblant parler des rubans, font songer au pénis ? Il s’agira, après avoir repéré et classé les équivoques sexuelles dans les textes de Molière (on pourra partir de l’annotation des Œuvres complètes de Molière dans l’édition dirigée par Georges Forestier et Claude Bourqui pour la Pléiade), de mettre en série les traductions italiennes de ces doubles-sens, depuis les premières traductions de Molière au XVIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. L’histoire de ces micro-traductions devrait constituer un observatoire de premier ordre pour appréhender la réception de Molière en Italie, autant que pour réfléchir à l’évolution de la façon de nommer les choses et, par conséquent, à la manière dont se crée, se perd et se reconstruit la connivence entre un texte et son public.
[1] Claude Favre de Vaugelas, Remarques sur la langue françoise, éd. Zygmunt Marzys, Genève, Droz, 2009, Préface, p. 48. Voir également le chapitre « Des équivoques ».
[2] Nicolas Boileau, Satires, Épîtres, Art poétique, éd. Jean-Pierre Collinet, Paris, NRF Poésie / Gallimard, n° 195, 1985, p. 151.


